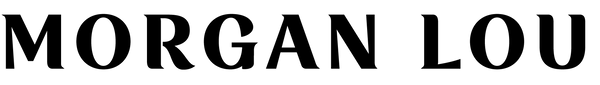"Bijou & Genre" : Et si l'ornement était politique ?
Share
Des parures de l’Antiquité aux podiums d’aujourd’hui, le bijou n’est pas qu’un simple accessoire. Il dit, il marque, il revendique. Miroir de l’identité, il se libère peu à peu des normes genrées pour devenir un outil d’expression à part entière.
Bijoux d’hommes, bijoux de femmes… vraiment ?
Dans les musées ou les livres d’histoire de l’art, une chose saute aux yeux : depuis toujours, les bijoux sont portés par tous les genres. Pharaons, empereurs romains, chefs tribaux, reines et guerrières… Les colliers, bracelets, bagues ou amulettes servaient à affirmer un rang, un statut ou une croyance, indépendamment du genre.
C’est l’ère moderne – en particulier l’époque victorienne – qui a renforcé une lecture binaire : les bijoux fins et décoratifs pour les femmes, les accessoires sobres et fonctionnels pour les hommes. Cette vision persiste encore, mais elle vacille.
Quand le bijou devient un geste subversif
À travers le XXe siècle, porter un bijou "hors normes" – un homme avec des boucles d’oreilles ou des colliers perles, une femme avec une chevalière massive – a souvent été perçu comme un acte de transgression. Et c’est justement là que le bijou prend une autre dimension : il cesse d’être décoratif pour devenir un outil de résistance, une déclaration d’identité.
Chez les personnes queer, trans ou non-binaires, le bijou sert à affirmer une féminité ou une masculinité réinventée, à jouer avec les signes extérieurs de genre, ou à les refuser tout simplement.

Symboles et codes dans les communautés LGBTQ+
Les bijoux ont aussi servi de codes de reconnaissance dans les communautés LGBTQ+, à des époques où la visibilité pouvait mettre en danger. Un anneau porté à l’oreille droite, une bague en forme de triangle rose, une chaîne spécifique autour du cou ou du poignet : autant de signes discrets, mais porteurs d’un sens fort.
Dans les années 70-80, ces bijoux permettaient de signaler une appartenance, de créer un lien, de résister à l’invisibilisation. Aujourd’hui encore, ces symboles sont réappropriés avec fierté, modernisés par une nouvelle génération de créateurs et créatrices queer.
La bijouterie non genrée : vers une esthétique fluide
Un changement s’opère dans les vitrines comme sur les podiums : de plus en plus de marques proposent des bijoux sans genre assigné. Les lignes sont épurées, les matières mélangées, les tailles adaptées à toutes les morphologies.
Des créateurs comme Alan Crocetti, Hatton Labs, ou encore les grandes maisons comme Boucheron explorent cette nouvelle liberté. On ne demande plus "pour femme ou pour homme", mais "quelle émotion ce bijou évoque-t-il chez vous ?".
« Le bijou n’est pas un simple ornement. Il est un miroir, un cri parfois silencieux, de l’âme qui le porte. »
Un manifeste porté au doigt, à l’oreille, au cou
Aujourd’hui, porter un bijou, c’est bien plus qu’une question de goût. C’est un choix intime, parfois politique. C’est une manière de raconter son histoire, de revendiquer sa liberté, de jouer avec les signes pour mieux s’en affranchir.
Et si le bijou devenait l’un des symboles les plus sensibles — et les plus puissants — de l’émancipation individuelle ?